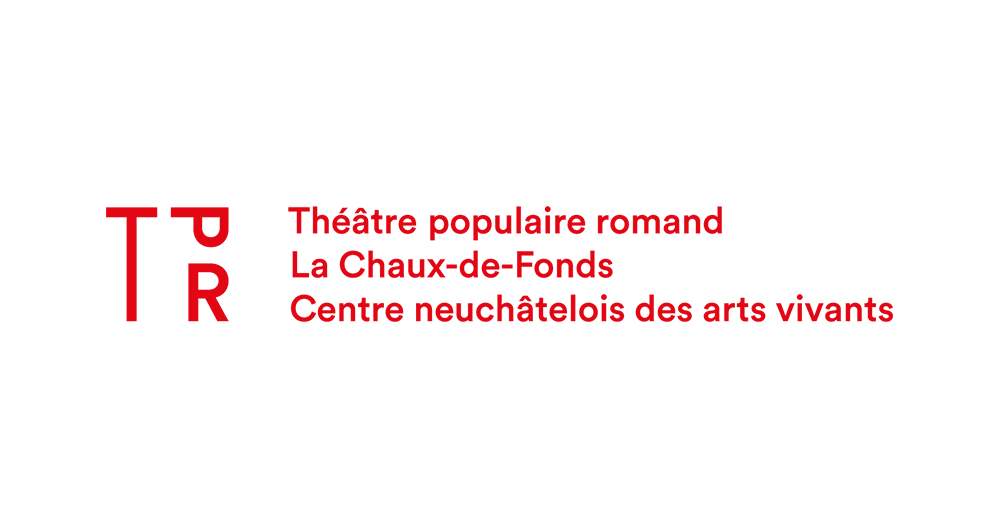La Chaux-de-Fonnière Fanny Wobmann publie son troisième livre, Les Arbres quand ils tombent, un récit autobiographique
Il en va de certains livres qui devraient attendre un plus grand mûrissement. Tel est ce troisième ouvrage de la Chaux-de-Fonnière – un peu Africaine – Fanny Wobmann, qui vit aujourd’hui à Neuchâtel.
Les Arbres quand ils tombent évoque son enfance au Rwanda et à Madagascar, où ses parents s’étaient installés avec ses soeurs, son père étant engagé par la DDC, sa mère avait aussi travaillé au Rwanda. En tant qu’adulte, elle ressent le besoin de raconter ces années de l’enfance à l’étranger. Mais, comme le disait Françoise Sagan : « La mémoire est aussi menteuse que l’imagination, et bien plus dangereuse avec ses petits airs studieux. »
Prudente, elle demande à ses parents s’ils donnent leur accord à la démarche du livre. C’est oui. Elle entame donc son récit, ses recherches, soutenue par les pouvoirs publics et différentes institutions. Le récit est finement mené et sait retenir l’attention : il est construit comme un aller et retour entre sa vie actuelle en Suisse et les images de sa mémoire dans les décors éloignés de son Jura natal.
Un mouvement parsemé d’échanges de messages avec Nirina, sa copine malgache avec qui elle a gardé des contacts, qui ne s’avéreront pas faciles quand celle-ci viendra en Suisse. Chemin faisant, l’auteure cite des écrivains, un article de presse, le lecteur apprend qu’en « malgache, le verbe être n’existe pas ».
Fanny Wobmann y va également de ses amours et de son questionnement concernant le racisme – plus les pages défilent, plus l’obsession de ce racisme se fait pesante. Est-elle raciste ? Les Blancs le sont-ils tous, profondément, de manière systémique ? Elle n’apporte pas de réponse socio-philosophique, mais ses témoignages suffisent à répondre par l’affirmative.
Le rythme instauré par ces divers éléments contribue à l’intérêt du livre, dont l’écriture sans fioriture, dépourvue de poésie, permet une lecture fluide, telle une glissade vers la fin. Celle-ci évidemment agit comme un boomerang. Découvrant le tapuscrit, sa famille est en colère. Nirina, elle, souhaite qu’elle en retire un passage. Mais Nirina est Malgache, il y a chez elle une autre acceptation des faits, elle se pliera donc à la décision de l’amie Blanche. Wobmann passera outre les fâcheries familiales, après tout, c’est son boulot, et au départ, tout le monde applaudissait.
C’est ici peut-être que l’âge et l’expérience interviennent : vingt ou trente ans plus tard, elle eût été moins frontale, trichant un peu dans l’écriture, afin de faire passer la pilule. Ses parents auraient disparu, ses soeurs pris de la bouteille, le livre eût sans doute été accepté avec des questions mais sans courroux.
Teinté de psy, que le jeune âge de l’auteure rend prégnant – elle souligne qu’elle n’aime pas blesser sa maman –, ce récit avec ses arbres, suisses et exotiques dégage une énergie solaire, dommage qu’il soit truffé de coquilles… Mais que font les éditeurs ?