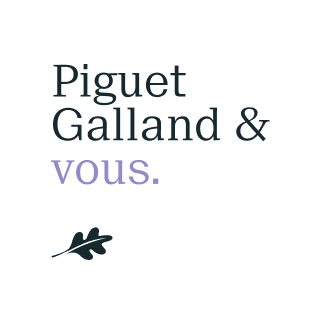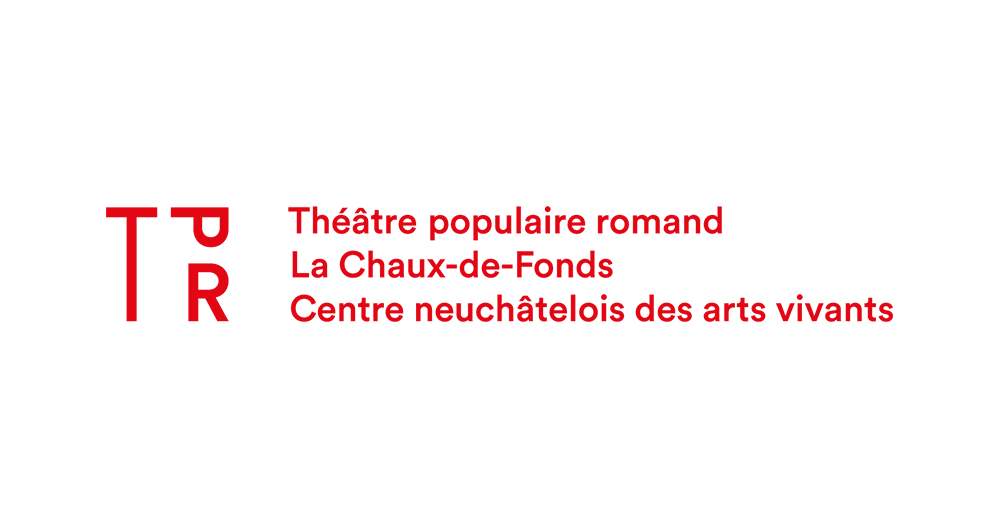Quand les friches industrielles deviennent des lieux de culture : exemple d’une brillante réhabilitation à La Chaux-de-Fonds
Des lieux de mort transformés en lieux de vie ! Comme d’autres friches industrielles, les anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds sont considérés aujourd’hui comme des trésors du patrimoine. Rénovés à grands frais, ils abritent souvent des activités culturelles. Avec la mondialisation, la viande qu’on achète sur d’autres continents, usines et abattoirs n’ont plus d’utilité aux portes de nos villes. Ces sites désaffectés offrent des espaces très recherchés dans un paysage urbain où on ne trouve plus un m2 de libre. À New York, l’ancien quartier des abattoirs, encore appelé le Meatpacking District, est devenu un haut lieu de la culture avec ses galeries et son nouveau Whitney Museum. Dans la Métropole horlogère, future Capitale culturelle suisse 2027, les anciens abattoirs seront au cœur des manifestations. Une vitrine pour tout le pays. Théo Huguenin-Élie, conseiller communal responsable de l’urbanisme et des bâtiments, raconte comment on en est arrivé là.
– Pourquoi la ville a choisi de rénover ses anciens abattoirs ?
– En 2014, le dernier boucher encore sur le site abat sa dernière bête. On se retrouve avec un bâtiment qui n’a plus de fonction, d’une valeur patrimoniale exceptionnelle mais en très mauvais état. En même temps, Polyexpo a été vendu à l’État, et on n’a plus de salle pour les grandes manifestations. On voit le potentiel des abattoirs mais il y a des résistances très fortes, entre ceux qui veulent vendre le bâtiment pour un franc symbolique et ceux qui veulent sa démolition.
– Il y a eu un tournant, un changement de mentalité ?
– Oui, c’est arrivé par étapes. La première prise de conscience remonte aux années 1970 quand la ville octroie un permis de démolir l’ancien manège, qui sera sauvé in extremis par un mouvement citoyen. En 1994, la ville est récompensée par le Prix Wakker pour ses efforts de valorisation du patrimoine. On observe un intérêt croissant pour l’héritage du Corbusier, le style sapin et cet urbanisme particulier fait par et pour l’horlogerie. En 2009, c’est la reconnaissance de l’Unesco. On se met à regarder notre patrimoine, y compris les friches industrielles, avec un œil nouveau.
– Pour la ville c’est un gouffre à fric, plus de 5 millions…
– Le bâtiment étant classé d’importance nationale, on reçoit des aides du canton qui peuvent aller jusqu’à 20 %. Notre chance c’est le regard nouveau sur le patrimoine industriel. On ne cherche plus à faire du neuf mais une rénovation douce, qui garde les traces de l’activité passée. Ça coûte moins cher.
– Garder le bâtiment dans son jus ?
– Oui, et ce caractère brut fait le charme du lieu. Ça plaît beaucoup aux entreprises horlogères qui viennent y faire leurs repas de fin d’année. Les réservations sont déjà complètes pour les mois de novembre et décembre jusqu’en 2026.
– Les autres utilisateurs ?
– Le HCC y organise son gala annuel, un repas à plus de neuf cents personnes. Il y a le Supermarché de Noël. Parmi les locataires, on trouve la brasserie La Comète, un skate-park, et le centre d’art contemporain Quartier Général.
– Quelle sera la place de ce site pour Capitale culturelle suisse 2027 ?
– Son centre névralgique ! Il s’y passera énormément de choses. Une visibilité dans toute la Suisse. Le défi pour la ville sera de poursuivre cette rénovation douce.
– Les friches industrielles transformées en espaces culturels, qu’est-ce que ça dit de notre société ?
– Un regard nouveau sur un patrimoine longtemps déconsidéré. Et un besoin d’espace dans des villes où l’on prône la surdensification. Ces espaces, on les trouve dans ces sites industriels qui avaient été construits en pleine campagne, comme les abattoirs, l’usine électrique ou les anciens moulins, et que la ville a fini par engloutir.
À lire sur le sujet : Meilleures pensées des Abattoirs, Jean-Bernard Vuillème, éditions d’En Bas.