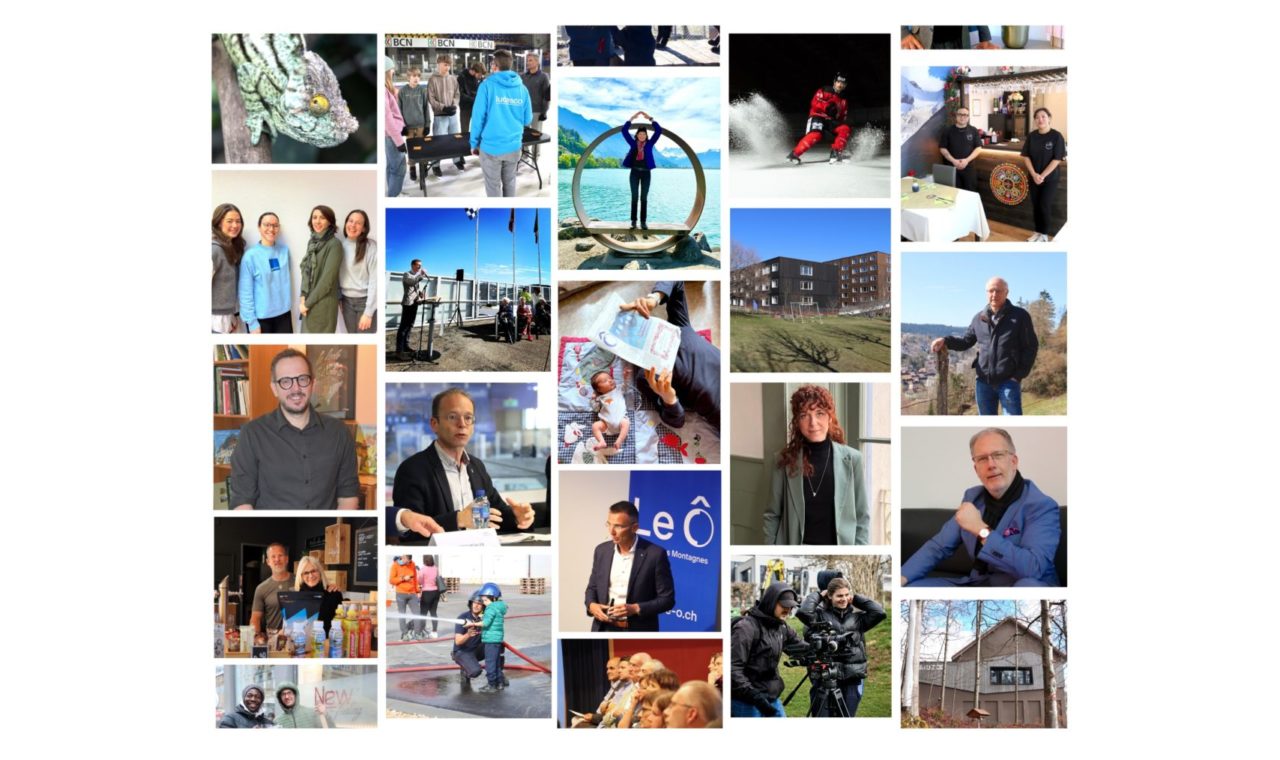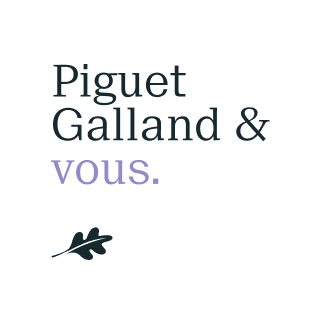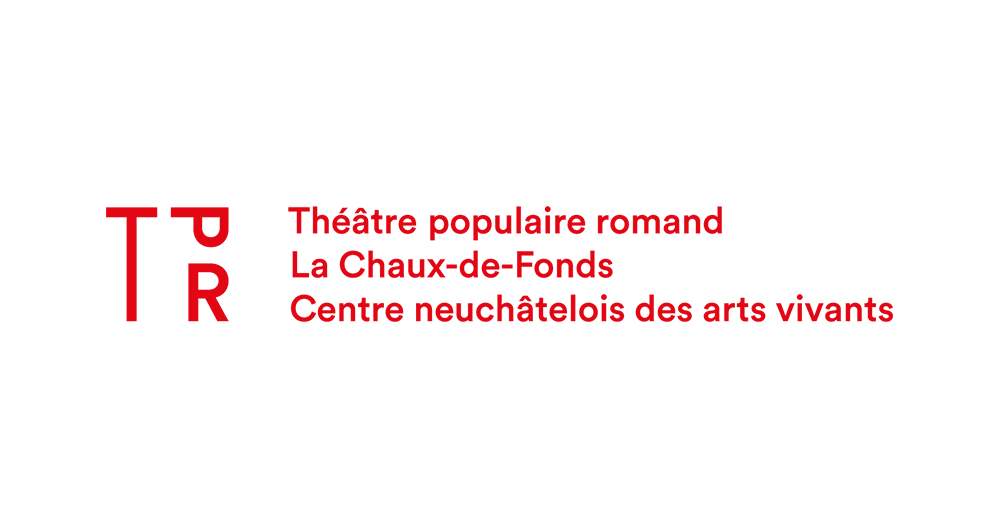Îlot de fraîcheur, la forêt du Communal est un lieu apprécié et ressourçant pour nos habitant·e·s. Sur plus de 42 hectares, elle constitue un véritable poumon, au bénéfice d’un biotope riche, naturel et varié. Entretenue par le service forestier intercommunal, son responsable, Hubert Jenni, nous fait les présentations !
« C’est une forêt dite jardinée. La canopée est entièrement développée en 3 dimensions, où la chlorophylle explose ! Avec une régénération naturelle ! » Les essences y sont multiples : principalement épicéas, sapins et douglas pour les résineux. Érables sycomores, frênes, hêtres et sorbiers pour les feuillus. « C’est comme une grande famille », nous confie Hubert, « il y a les jeunes pousses et les ados, qui grandissent aux côtés de leurs parents et grands-parents, qui leur ont donné la vie. »
Véritable barrage contre les inondations
Cette forêt est également multifonctionnelle : production de bois, barrage contre les inondations, filtre à eau, préservation de la biodiversité, et bien sûr espace récréatif avec son parcours Vita et ses parcours pédagogiques. Pour Hubert, « bien desservie en transports publics, la forêt du Communal constitue un véritable bol d’air pour les familles et les sportifs ! De plus, cette forêt n’est pas inclinée, mais se situe sur un plateau, ce qui est plutôt rare dans nos Montagnes ! » L’un des points d’attraction est bien sûr le « Grand Douglas » ou « Sapin président ». D’une hauteur de plus de 53 m et un diamètre de 135 cm, cet arbre plus que centenaire trône au-dessus de la canopée. Depuis 2013, des arbres de la même espèce sont plantés chaque année à proximité pour fêter la naissance des enfants de la cité.
Entièrement ravagée par les flammes en 1898
En 1382, Jean III d’Aarberg, seigneur de Valangin, autorise le défrichement du lieu, offrant un pâturage commun « aux communiers ». En 1873, sur les flancs dénudés, la ville construit une ferme, accueillant une soixantaine de vaches, avant de la louer à des fermiers. Celle-ci est détruite par les flammes en 1898. Toutefois, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, en réponse à l’industrialisation, la nostalgie d’un monde plus humain, tourné vers la nature, fait renaître l’image du « paysan-artisan ». De grands projets de renaturation sont alors lancés : en 1894, le jardin public, puis en 1899, le reboisement du Communal, de la Joux-Pélichet et de la Combe-Girard. Albert Pillichody, polytechnicien et visionnaire, et son équipe réalisent la forêt jardinée qui fait aujourd’hui la fierté des Loclois·e·s !