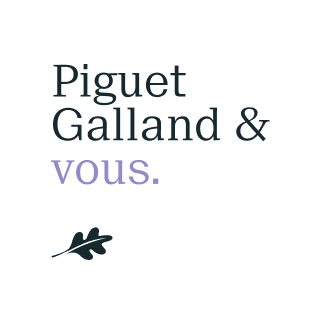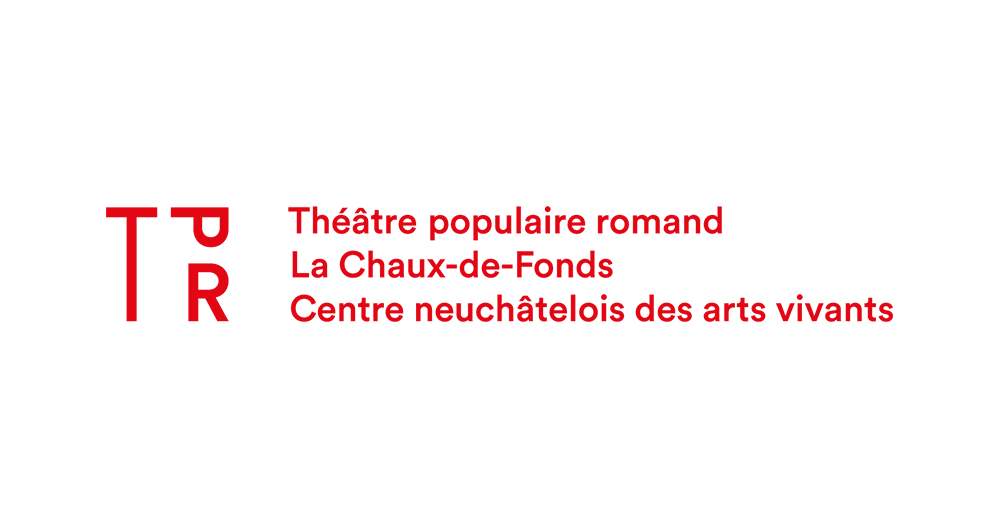Menace djihadiste au Mali
Alors que la France commémore les attentats terroristes de novembre 2015, l’inquiétude gagne Bamako et toute l’Afrique subsaharienne. Mariam Cissé, une célèbre influenceuse malienne, a été enlevée et exécutée publiquement par un commando du JNIM (groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda). L’Occident appelle ses ressortissants à quitter urgemment le Mali. La stratégie des djihadistes est double : renverser la junte militaire au pouvoir en instillant la terreur et en asphyxiant économiquement la capitale. L’attaque de convois d’essence en provenance du Sénégal et de la Côte d’Ivoire entraîne d’immenses embouteillages et des pénuries d’électricité. L’armée malienne et les mercenaires russes de l’Africa Corps ne parviennent pas à juguler l’avancée de ses 6 000 hommes. Animés par la volonté d’instaurer un califat et les lois de la charia, les escadrons de la mort sont aux portes de Bamako. L’histoire se répète au Mali, en proie à la terreur djihadiste depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2012. Initiée un an plus tard par François Hollande, l’intervention militaire française a fait long feu.Trop coûteuse en moyens et en hommes, insuffisamment axée sur la gouvernance et le développement du pays, elle était vouée à l’échec avec le ressentiment très marqué à l’égard de l’ancien colon français et la montée en puissance de la Russie. La crise malienne illustre à la fois la fin de l’influence française sur le continent africain et l’échec de la Russie à combattre la terreur djihadiste en Afrique. Soutien principal de la junte militaire malienne depuis le départ des forces françaises en 2022, Moscou s’embourbe dans les sables du Sahel. L’enjeu est planétaire. De l’aveu de Nicolas Lerner, directeur de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le continent africain est « devenu l’épicentre du djihadisme » au niveau mondial.