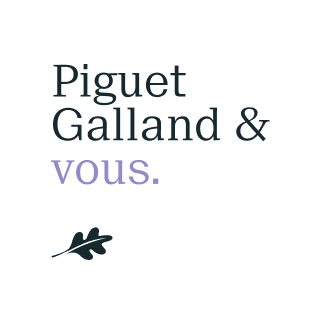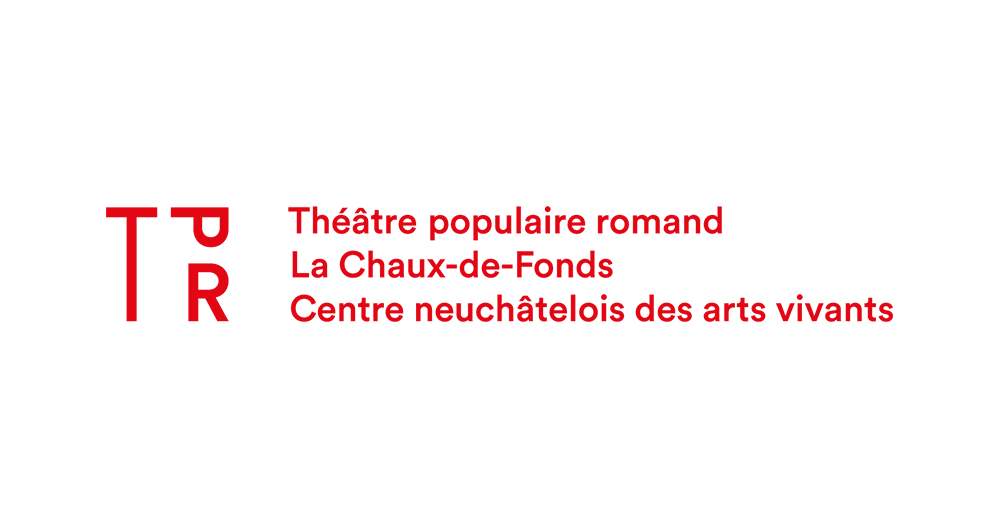En 1995, notre canton se dotait d’une loi sur la politique familiale et l’égalité entre hommes et femmes. Pour constater les effets de la loi, l’Office cantonal de la politique familiale et de l’égalité coorganise avec la professeure émérite Ellen Hertz un colloque sur le sujet, le vendredi 14 novembre, à La Chaux-de-Fonds. Malgré les progrès accomplis, l’égalité demeure un défi majeur dont la résolution requiert un engagement fort. La journée sera l’occasion de réunir des expertes et experts de l’égalité et de la politique familiale, actifs au niveau suisse et international.
Dans une interview commune, Le Ô fait le point de la situation, 30 ans après l’introduction de la loi en questionnant Stéphanie Lachat, actuelle codirectrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes et son ancienne directrice, Patricia Schulz, en poste à Berne de 1994 à 2010.
En 30 ans, qu’est-ce qui a changé dans l’application de la loi au niveau fédéral et neuchâtelois ?
Les lois datent de 1995, mais la situation des femmes n’a pas été transformée pour autant dans le domaine de l’emploi. Selon la récente évaluation intermédiaire de la Leg, la moitié des patrons ne respectent pas tout ou partie de leurs obligations, et cela bien que la Confédération mette à leur disposition un instrument gratuit d’analyse des salaires. Celui-ci peut d’ailleurs aussi être utilisé pour le contrôle des marchés publics par les autorités. Nous attendons avec grand intérêt l’évaluation des effets de la loi en 2027 et les mesures de renforcement qui pourraient en résulter.
Patricia, quel était votre principal défi il y a 30 ans ?
Obtenir que la Suisse respecte dans la réalité quotidienne le principe d’égalité entre femmes et hommes, avec les changements sociétaux qui l’accompagnent… Cela reste encore un objectif en 2025.
Et vous Stéphanie ?
En 1995, étudiante sur les bancs de l’Uni de Lausanne, je m’engageais pour la prise en compte du genre dans les recherches. Pour qu’il devienne évident de se poser la question des relations hommes-femmes, quel que soit le sujet analysé. La recherche scientifique est essentielle car elle permet de comprendre le monde et de le changer.
Quelle est votre clé de lecture des différences de revenu ?
C’est de la pure discrimination. La loi interdit les différences basées sur l’état civil ou la situation familiale. Cependant, une étude publiée par le Conseil fédéral l’été dernier souligne que la parentalité accentue les écarts salariaux : les femmes mariées ayant des enfants gagnent en moyenne 21 % de moins (en équivalent plein temps) que les hommes au statut similaire. Un autre chiffre montre que les femmes gagnent en moyenne 43 % de moins que les hommes sur l’entier de leur vie active. Des critères indirectement discriminatoires comme l’ancienneté et le taux d’occupation participent largement à ces inégalités.
N’est-ce pas déjà à la crèche et au jardin d’enfants que se marquent les inégalités ?
Les inégalités de genre sont présentes partout et ça commence très tôt ! Les attentes envers les filles et les garçons demeurent très différentes, dès les premières heures. Très tôt, les enfants observent aussi que maman s’occupe plus souvent d’eux au domicile et que c’est elle qui prend en charge toute la maisonnée. C’est ainsi que les stéréotypes se fabriquent…
Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik parle de différences génétiques pour expliquer les différences de comportement conduisant aux inégalités, est-ce votre avis ?
Boris Cyrulnik n’est pas une référence scientifique. Mettre les gens dans des cases, que cela soit sur une base génétique ou autre, revient à créer des stéréotypes et à réduire les libertés en créant des inégalités.
Souvent approchées pour siéger dans des Conseils d’administration ou prendre des responsabilités dans la vie civile ou militaire, les femmes refusent. Pourquoi ?
Parce qu’elles sont déjà trop occupées… Du fait qu’elles assument plus d’heures de travail que les hommes. Lorsqu’on additionne emploi et activités de care, pour les femmes avec enfants de moins de 15 ans, la moyenne frôle les 78 heures par semaine.
Comment faudrait-il aider les femmes actives qui hésitent ou refusent à s’engager dans des postes stratégiques ?
Plutôt que « d’aider » les femmes, il faut mettre en place des mécanismes qui garantissent la parité. Donner les moyens matériels aux femmes de s’engager par une répartition égalitaire des activités rémunérées et non-rémunérées entre les femmes et les hommes. Concrètement, cela signifie une plus grande implication des hommes dans les tâches domestiques et familiales. La superwoman qui fait une triple journée professionnelle, politique et… familiale est un modèle inatteignable.