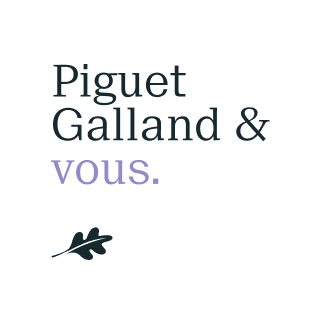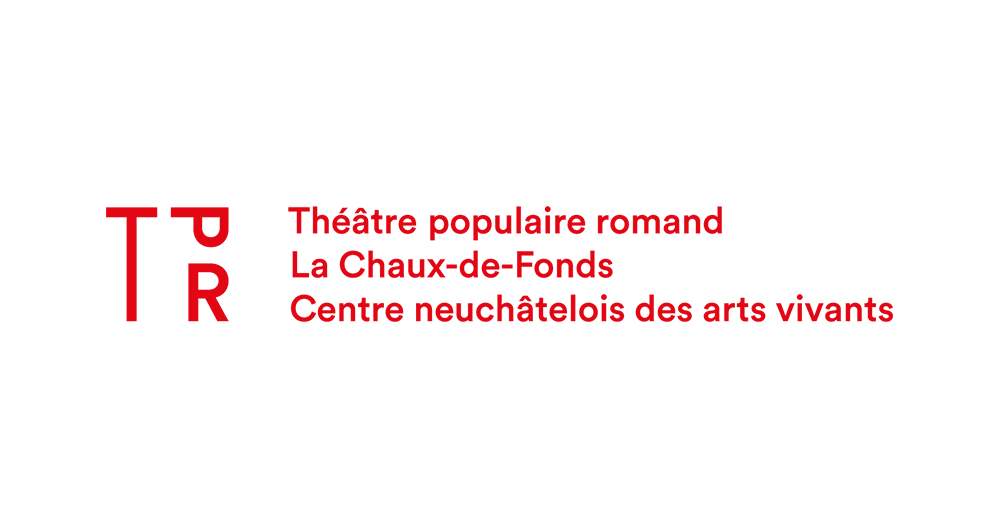Pas de corbeau mais un renard, plutôt pénard… Tout juste ne dirait-il pas « qu’est-ce qu’on regarde à la télé ou sur Netflix ce soir ? »
Ces photos ont été prises dans le jardin de Marine et Jérémy dans le quartier chaux-de-fonnier des Cerisiers. « On a été un peu surpris de tomber sur un visiteur un peu particulier : un renard confortablement allongé sur notre canapé de jardin. Une scène aussi étonnante qu’adorable », rapportent-ils encore amusés par la situation. Cette anecdote est révélatrice de la présence toujours plus perceptible du renard dans l’environnement proche des villes. De là à dire que le renard est notre nouveau compagnon de salon, il n’y a qu’un pas ?
Contrairement à ce que l’on croit, le Covid- et le confinement qui a été avec – n’est pas le point de départ du développement du nombre de renards présents dans les villes. Dès les années 1950 – 1960, sa population a continuellement augmenté en Suisse. L’intensification de l’agriculture après la 2e Guerre mondiale a augmenté la quantité de résidus de récolte au sol. Couplée à l’urbanisation des zones agricoles, à la multiplication des déchets issus de la société de consommation et au compostage de plus en plus important, cela a contribué à fournir un apport illimité à la faune.
Zones agricoles grignotées et villes de plus en plus vertes poussent à la cohabitation
Seule la rage, qui a sévit entre 1967 et 1985, a permis de freiner la prolifération des renards. Une fois la rage maitrisée, les effectifs sont repartis à la hausse et les renards se sont rapprochés des villes, particulièrement au cours des vingt dernières années. Il y a plusieurs raisons à cela. Autrefois zones tampons, les zones agricoles sont grignotées par l’espace urbain, ce qui rapproche inéluctablement les deux habitats (homme – animal). De plus, les villes sont de plus en plus vertes. Elles font entrer la nature en ville et, avec elle, les animaux qui vont avec. Par ailleurs, cette espèce s’est développée en zone urbaine et ne considère plus l’homme comme un prédateur. Ce nouvel équilibre amuse, questionne ou inquiète. Une certitude : il place au centre du « salon » le sujet de la coexistence entre le citadin et l’animal.